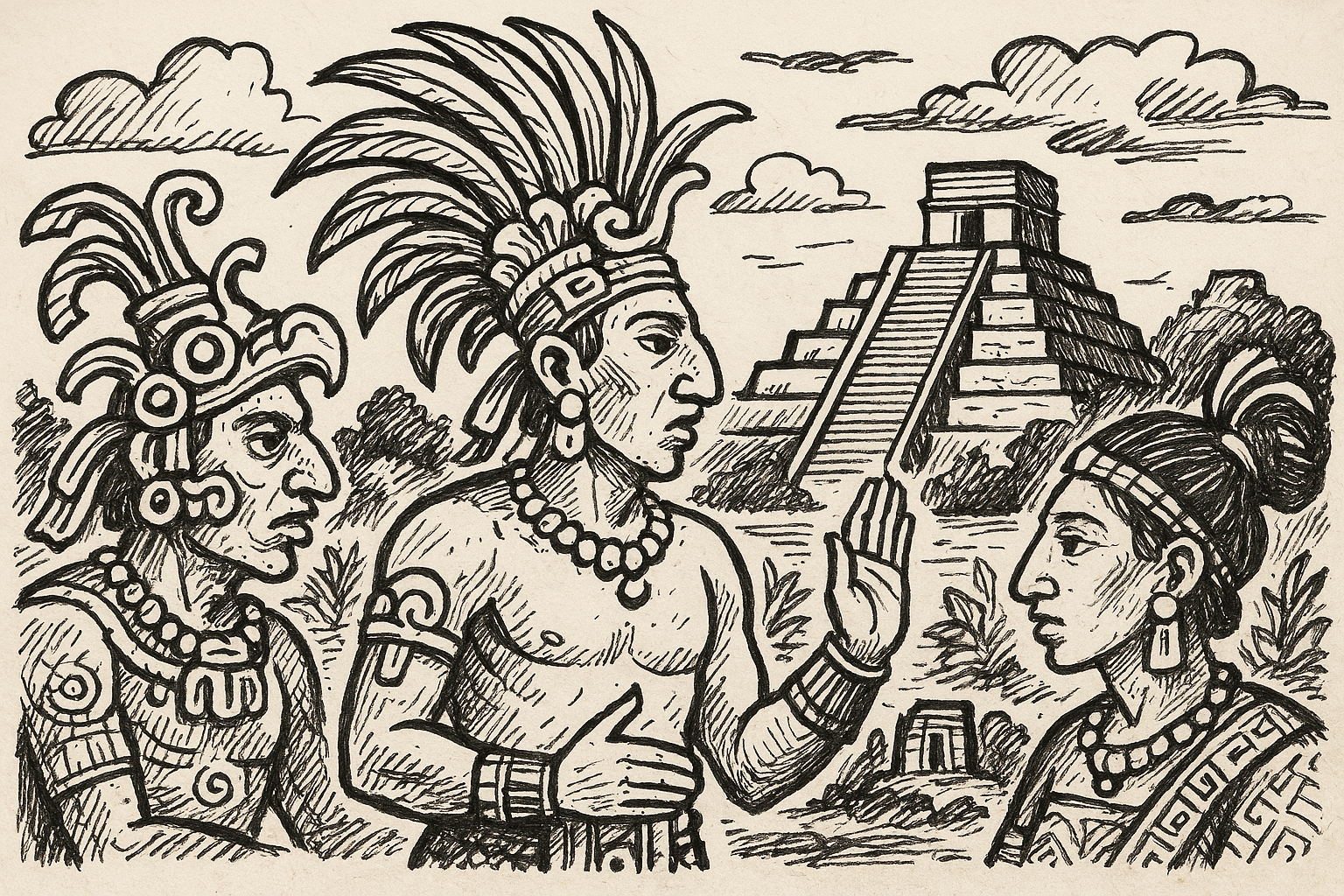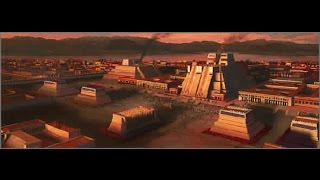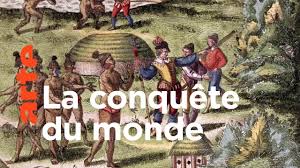La Guerre de Cent Ans, qui s’étend de 1337 à 1453, est souvent perçue comme un long conflit entre la France et l’Angleterre, ponctué de batailles célèbres et d’épisodes épiques. Si la question de la souveraineté du trône de France est au cœur de ce conflit, elle n’est en réalité que la partie émergée de l’iceberg.
Derrière cette guerre se cachent des enjeux plus vastes : économiques, territoriaux, politiques et culturels. Analysons les véritables raisons de cette guerre qui a redéfini l’histoire de l’Europe médiévale.
Une querelle dynastique en apparence
Officiellement, la Guerre de Cent Ans commence en 1337, lorsque le roi d’Angleterre Édouard III revendique le trône de France à la mort de Charles IV le Bel, dernier fils de Philippe le Bel. Ce dernier meurt sans héritier mâle direct, ce qui ouvre une crise de succession.
En vertu de la loi salique, qui interdit aux femmes de régner et de transmettre le trône, les barons français refusent la prétention d’Édouard III, dont la mère, Isabelle de France, est fille de Philippe le Bel. Ils désignent alors Philippe VI, issu d’une branche cadette des Capétiens, les Valois.
« La loi salique n’était pourtant pas un texte de loi officielle, mais une tradition coutumière interprétée à l’avantage des Capétiens. »
Ainsi, bien que la querelle dynastique serve de déclencheur, elle n’est qu’un prétexte à un conflit bien plus profond.

Une rivalité féodale et territoriale
Depuis le mariage d’Aliénor d’Aquitaine avec Henri Plantagenêt en 1152, l’Angleterre contrôle une grande partie du territoire français, notamment l’Aquitaine et la Normandie. Or, ce duché d’Aquitaine, bien que sous la couronne anglaise, reste un fief du roi de France.
Ce paradoxe féodal provoque des tensions constantes : les rois d’Angleterre ne supportent pas de devoir prêter allégeance à leur rival français pour ces territoires.
« L’Aquitaine représentait un enjeu économique majeur : ses vins et son commerce maritime étaient essentiels pour l’Angleterre. »
En 1337, Philippe VI confisque l’Aquitaine, donnant à Édouard III un motif concret pour entrer en guerre. L’enjeu territorial est donc fondamental dans l’opposition entre les deux royaumes.
Les territoires clés de la guerre
- L’Aquitaine : source de richesse et point de friction entre les deux couronnes.
- La Normandie : ancien fief anglais repris par les Capétiens.
- Calais : une porte d’entrée stratégique pour les Anglais en France.
- La Bretagne : objet d’enjeux dynastiques entre les deux royaumes.
Une guerre économique sous-jacente
Derrière les batailles médiévales se cache une guerre économique. L’Angleterre, dont l’économie repose en grande partie sur l’exportation de la laine, dépend des relations commerciales avec la Flandre, une région sous influence française.
Or, en soutenant les Flamands contre la France, l’Angleterre tente d’assurer son monopole commercial. Les Français répliquent en entravant ce commerce, ce qui contribue à aggraver les tensions.
« Le soutien d’Édouard III aux tisserands flamands lui permet d’obtenir un puissant allié économique et militaire. »
Ainsi, la Guerre de Cent Ans n’est pas seulement une guerre de couronnes, mais aussi un affrontement entre deux puissances commerciales.
Les enjeux économiques du conflit
- Le commerce de la laine : vital pour l’économie anglaise, menacé par la politique française.
- Les ports stratégiques : contrôler Calais ou Bordeaux, c’est maîtriser le commerce maritime.
- La fiscalité : chaque camp lève des impôts de plus en plus lourds pour financer la guerre.

Un affrontement culturel et identitaire
Au fil du conflit, la Guerre de Cent Ans dépasse la simple lutte entre deux dynasties pour devenir un affrontement entre deux nations. Avant cette guerre, l’idée de nation était encore floue : la France était un patchwork de territoires gouvernés par des seigneurs aux allégeances variées.
Progressivement, ce conflit forge l’identité française et anglaise. Les rois de France centralisent leur pouvoir, renforçant l’idée d’un État fort face à l’envahisseur. De son côté, l’Angleterre se détourne progressivement du continent pour affirmer son insularité et son identité propre.
« La guerre transforme les mentalités : naître sujet du roi de France ou d’Angleterre devient une marque d’identité. »
Cette évolution contribue à la naissance des États modernes et du sentiment national.
Les transformations majeures
- Naissance du patriotisme : Jeanne d’Arc incarne l’idéal d’une France unifiée.
- Centralisation du pouvoir : les rois de France affirment leur autorité sur les seigneurs.
- L’isolement anglais : l’Angleterre se tourne vers la mer et prépare son avenir impérial.
Une guerre technologique et militaire
Enfin, la Guerre de Cent Ans est aussi une révolution dans l’art de la guerre. Les batailles emblématiques, comme Crécy (1346) et Azincourt (1415), montrent la suprématie des archers anglais et des nouvelles tactiques militaires.
L’utilisation du longbow (arc long) par les Anglais leur donne un avantage décisif contre la chevalerie française, qui mettra du temps à s’adapter à ces nouvelles réalités.
« À Azincourt, les archers anglais déciment la chevalerie française en quelques heures, prouvant l’obsolescence des vieilles tactiques. »
En réponse, la France développe une artillerie plus efficace et modernise son armée, notamment sous Charles VII, qui crée les premières compagnies d’infanterie permanente.
Innovations militaires majeures
- L’arc long anglais : arme décisive contre la cavalerie.
- L’artillerie française : les premiers canons révolutionnent les sièges.
- La discipline militaire : les troupes permanentes remplacent les levées féodales.
Conclusion : une guerre aux multiples visages
Si la Guerre de Cent Ans est souvent réduite à une rivalité dynastique, elle est en réalité un affrontement bien plus vaste, mêlant enjeux économiques, territoriaux, militaires et culturels.
En près de 120 ans, ce conflit a profondément transformé la France et l’Angleterre, forgeant les bases des États modernes et modifiant les stratégies de guerre.
« De la querelle féodale à la naissance des nations, la Guerre de Cent Ans est un tournant majeur de l’histoire européenne. »
Finalement, ce conflit dépasse largement la question du trône de France : il marque l’entrée dans une nouvelle ère politique et militaire, où la nation et la modernité commencent à prendre forme.