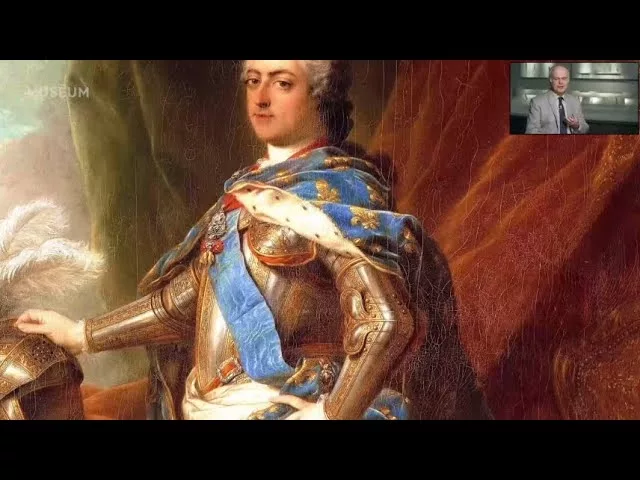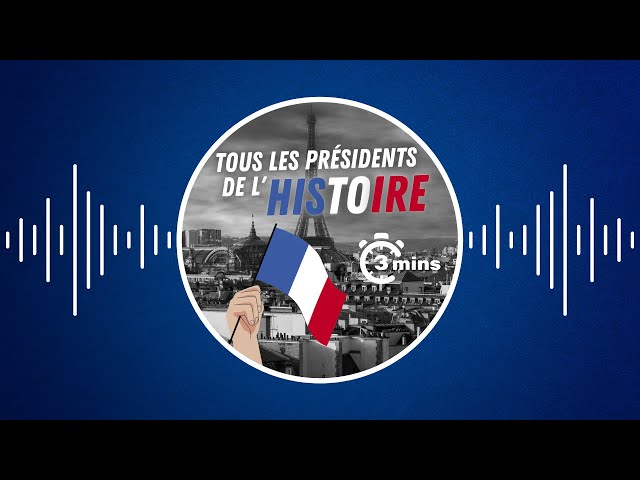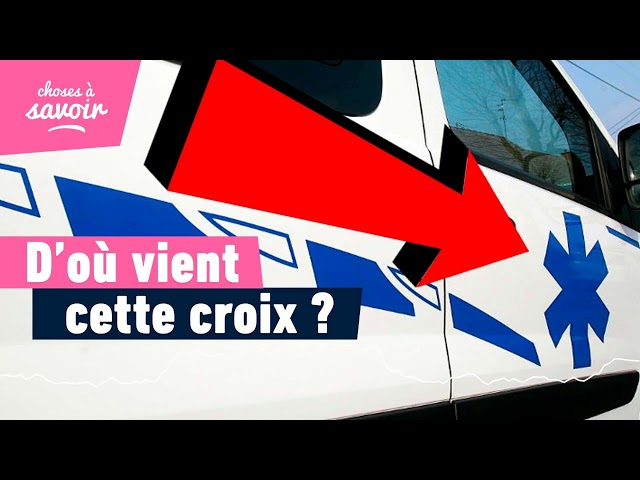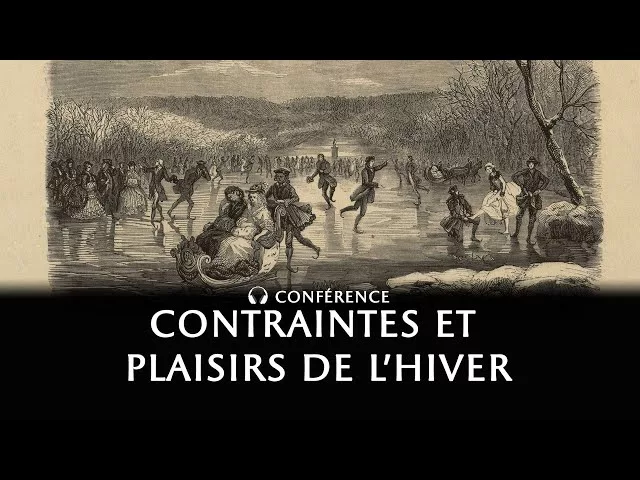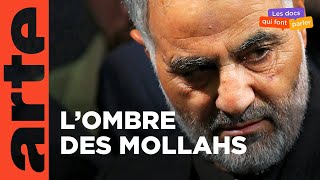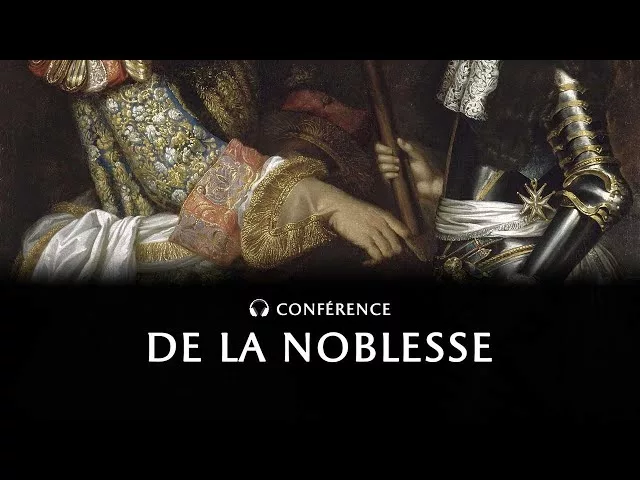Tout le monde, ou presque, a entendu parler du Tibet, cette région d’Asie centrale formée d’un vaste plateau, bordée par la Chine, l’Inde, le Bhoutan et le Népal. Situé en moyenne à une altitude de 4 500 mètres, le Tibet apparaît comme la première marche conduisant à l’Himalaya, le toit du monde…
Pour beaucoup, le Tibet est la terre d’origine du dalaï-lama, symbole du bouddhisme ; pour d’autres, c’est également un pays martyr dont on connaît peu l’histoire, si ce n’est à travers quelques films. Pour tous cependant, le Tibet apparaît comme une terre fascinante, une terre presque inconnue…
Les premières incursions occidentales
À peine cité par Marco Polo dans Le Livre des Merveilles, le Tibet est si reculé, si inaccessible, qu’il restera longtemps ignoré des explorateurs, à quelques exceptions près. Il faudra attendre le XVIIIe et surtout le XIXe siècle, pour qu’il retienne l’attention des plus téméraires d’entre eux.
Selon une vieille chronique germanique, il semble que ce soit saint Hyacinthe qui, le premier, pénétra au Tibet au XIIIe siècle. Au siècle suivant, c’est le tour du moine Odorico de Pordenone qui, de 1316 à 1330, résida à Lhassa, la capitale de ce royaume interdit.
Puis, durant trois siècles, plus rien : pas un voyageur, pas un religieux. Ce n’est qu’en 1624 que le jésuite Antonio d’Andrada, poursuivant, selon l’exemple de saint François Xavier, la conversion de l’Asie, pénètre au Tibet. Il sera bientôt imité par d’autres religieux.
En 1661, les pères Grueber et Dorville passent de Chine en Hindoustan en traversant le Tibet. Les pères Freyre et Désideri viennent en 1690 prêcher dans ce pays.
Un pays interdit aux Européens
Au cours du XVIIIe siècle, ce sont les capucins qui prennent le relais et viennent en nombre évangéliser – en vain – le Tibet. Durant cette même époque, des Anglais, des Français, des Hollandais parcourent le pays, bien que, depuis l’installation des Chinois au Tibet, au milieu du XVIIIe siècle, la ville de Lhassa soit strictement interdite aux Européens.
Cette interdiction ne fait qu’attiser les désirs d’exploration : le Tibet devient encore plus fascinant parce qu’interdit.
Le mouvement s’intensifie au XIXe siècle. En 1811, le docteur Manning parcourt le pays, déguisé en médecin indigène. Entre 1844 et 1846, deux missionnaires lazaristes, Huc et Gabet, entreprennent un périple audacieux en Mongolie et pénètrent à Lhassa.
Les deux « lamas de Jéhovah », comme ils se faisaient appeler, seront les derniers Européens à entrer dans la cité sainte du Tibet, la résidence du Bouddha vivant. Il faudra attendre 1904 pour qu’un Anglais, appuyé d’un corps d’armée, y pénètre à son tour.
Peu après, le Tibet semble vouloir se fermer définitivement. En 1854, la Société des Missions, à peine établie au Tibet, en est chassée. Enfin, à la fin du XIXe siècle, Gabriel Bonvalot et Henri d’Orléans racontent leur périple, l’un des plus audacieux du siècle.
L’aventure de Bonvalot et du prince d’Orléans
Lorsqu’il décide d’accomplir ce voyage, Pierre-Gabriel Bonvalot est déjà un habitué de cette partie du monde, qui est devenue depuis « son domaine », sa spécialité.
En 1880, il parcourt le Turkestan, Boukhara, Samarkande, explore les contreforts des monts Thian Shan et s’avance jusqu’au fleuve Amour. En 1885, il visite le Lenkoran, en Perse. À deux reprises, il tente de pénétrer en Afghanistan, sans succès, puis organise une première expédition vers le plateau du Pamir, le « toit du monde », qu’il compte atteindre en plein hiver.
L’aventure tibétaine ne l’effraie donc pas, malgré les conditions très dures que les explorateurs vont rencontrer.
Des conditions extrêmes
Au Tibet, les vents soufflent avec une violence inouïe et les températures peuvent descendre à 40° au-dessous de zéro. La végétation est maigre, le relief dangereusement accidenté, et les quelques deux mille habitants sont hostiles à toute pénétration.
Peu importe pour Bonvalot et Orléans, ils comptent bien arriver jusqu’à Lhassa, la cité interdite aux Européens.
Une expédition ambitieuse
Le 6 septembre 1889, ils partent de Kouldja, aux confins de l’Empire chinois, puis gagnent Tcharchlik, franchissent l’Altyntag et traversent la vallée de Tsaï-Dam.
Ils ont réussi… enfin presque : les deux explorateurs vont effectivement s’approcher de Lhassa, mais ne pourront entrer dans la ville. Déçus, ils poursuivent néanmoins leur voyage vers l’est, atteignent Batang, puis le 29 septembre 1890, Hanoï, dans l’actuel Viêt-Nam.
Une moisson d’observations
Ce périple, qui a duré plus d’un an, leur aura permis de découvrir des régions totalement inexplorées. Surtout, ils ont pu observer les habitants des pays traversés, leurs coutumes, la faune, la flore, et ramener ainsi une quantité d’informations extrêmement précieuses en Europe.
Une renommée bien méritée
Devenus d’éminentes célébrités, Gabriel Bonvalot et Henri d’Orléans vont pouvoir tenir en France de nombreuses conférences sur leur extraordinaire randonnée asiatique. Le public, tant à Paris qu’en province, leur réservera un accueil chaleureux.
Déjà, le Tibet fascine…