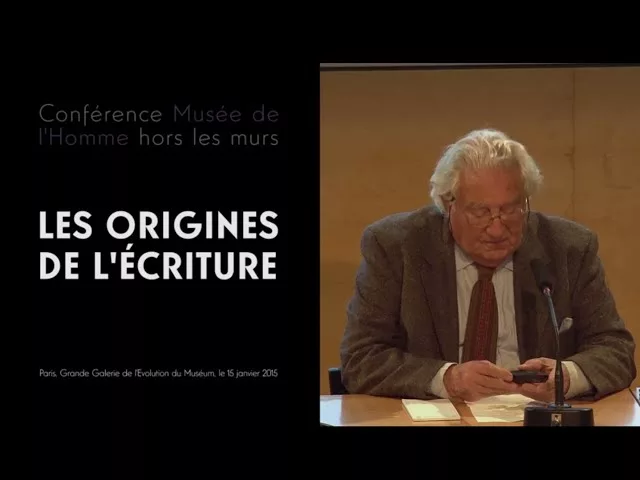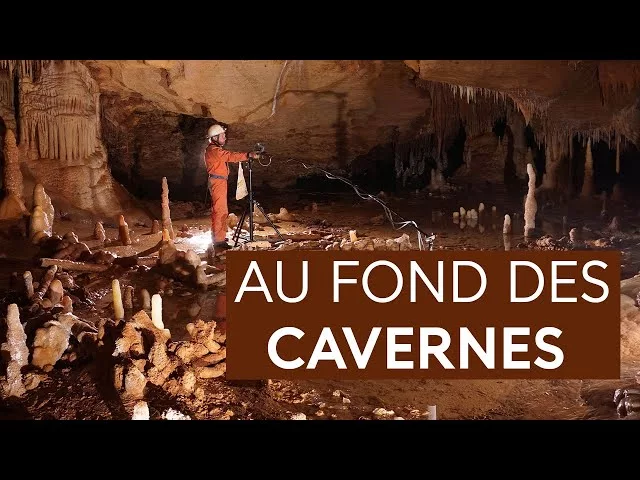Vers –12 000, la grande glaciation, également connue sous le nom de glaciation de Würm en Europe, touche enfin à sa fin. Pendant des millénaires, d’énormes glaciers ont recouvert une grande partie du continent, façonnant les paysages et influençant profondément le climat et les écosystèmes.
Avec le retrait progressif des glaces de l’inlandsis, un nouveau paysage émerge. Les vastes plaines de glace laissent place à d’immenses forêts de genévriers, de bouleaux et de chênes, marquant un changement écologique significatif. Ces nouvelles forêts offrent des habitats riches et diversifiés pour la faune, ainsi que des ressources essentielles pour les populations humaines.
À cette époque, l’homme est déjà présent dans ces régions. Depuis environ –15 000, il est engagé dans l’âge magdalénien, une période caractérisée par l’utilisation d’outils en pierre taillée et des pratiques de chasse sophistiquées.
Cette période marque la fin de l’époque de la pierre taillée, également connue sous le nom de Paléolithique, qui a vu l’évolution des premières technologies humaines. À l’horizon se profile l’entrée dans une nouvelle ère, celle du Néolithique, caractérisée par l’utilisation de la pierre polie et surtout par l’essor de l’agriculture.
Cette phase de transition, entre le Paléolithique et le Néolithique, est appelée Mésolithique. C’est une période de profondes transformations sociales et technologiques, où les humains commencent à expérimenter de nouvelles méthodes de subsistance, préparant le terrain pour les grandes civilisations agricoles.
Les débuts de l’agriculture et de l’élevage
L’élevage et l’agriculture ne se développent pas de manière simultanée sur tout le pourtour méditerranéen. En Anatolie, ces nouvelles techniques apparaissent vers –8 000, marquant le début d’une révolution qui transformera radicalement les sociétés humaines.
Dans les régions orientales et la Méditerranée orientale, l’élevage précède souvent l’agriculture. Les premiers éleveurs commencent par domestiquer des animaux sauvages, assurant ainsi une source régulière de viande, de lait et de laine. En revanche, en Europe centrale et en Suisse, le développement de l’agriculture précède généralement l’élevage.
Les premières communautés agricoles y cultivent des céréales et des légumineuses, posant les bases d’une économie agricole complexe. En France, la culture des espèces végétales débute vers –5 000 dans le sud du pays. Les premières tentatives de domestication des plantes se concentrent sur les espèces locales adaptées au climat et au sol.
Il est probable que les procédés agricoles aient émergé progressivement, par des processus d’essais et d’erreurs sur plusieurs générations. Les premières formes d’agriculture consistent probablement à entretenir les sites de cueillette en arrachant les mauvaises herbes et en récoltant les graines des plantes sauvages, telles que la vesce, la lentille ou le pois chiche.
Cette forme de cueillette persistante concerne aussi les céréales, dont l’utilisation remonte à des milliers d’années avant le développement de l’agriculture systématique. Les meules à broyer et la production de farine existaient déjà dans certains groupes avant le passage à une agriculture systématique. Ces innovations permettent aux premières communautés agricoles d’assurer une production alimentaire plus stable et prévisible, favorisant ainsi la croissance démographique et le développement social.
L’émergence de l’agriculture systématique
Depuis –12 000, le Moyen-Orient, y compris la vallée du Jourdain et la Mésopotamie, est couvert de céréales sauvages. Ces vastes étendues de graminées sauvages fournissent une abondance de nourriture pour les populations humaines et animales.
Dès cette époque, de petits villages de communautés sédentarisées commencent à apparaître. Ces premières communautés agricoles s’établissent dans des régions favorables, où les conditions climatiques et les ressources naturelles permettent une vie sédentaire. À Mallaha en Israël, par exemple, on trouve un ensemble de cinq maisons rondes, témoignant d’une organisation sociale complexe et d’une vie communautaire structurée.
Les Khiamiens de la région de Damas sont parmi les premiers à envisager la collecte et le ressemis des graines, marquant un pas significatif vers l’agriculture systématique. Ces innovations permettent de garantir une production alimentaire plus stable et prévisible, réduisant la dépendance aux ressources sauvages et aux fluctuations saisonnières.
L’agriculture systématique implique également le développement de nouvelles technologies, telles que les outils agricoles et les techniques de gestion des sols, qui améliorent l’efficacité et la productivité des cultures. Ces avancées favorisent la croissance démographique, l’expansion des villages et la complexification des structures sociales, jetant les bases des premières civilisations agricoles.
La domestication des animaux
En ce qui concerne la domestication des animaux, c’est le chien qui est apprivoisé en premier, probablement à partir du loup. Cette relation symbiotique entre l’homme et le chien apporte de nombreux avantages, notamment pour la chasse, la protection et la compagnie.
Ensuite, viennent le mouton et la chèvre, qui sont également domestiqués dans la région du croissant fertile. Ces animaux fournissent non seulement de la viande, mais aussi du lait, de la laine et d’autres ressources essentielles. Plus tard, le porc et les volailles, vers –5 000, entrent dans le processus de domestication, enrichissant encore la diversité des ressources animales disponibles.
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ces espèces jouent un rôle crucial dans les économies agricoles. Le cheval, en revanche, ne sera maîtrisé que bien plus tard, à la fin du Néolithique. Souvent, l’élevage implique des solutions transitoires consistant à suivre les troupeaux, retardant ainsi le passage à la sédentarisation complète.
Cette forme de semi-nomadisme permet aux premières communautés d’exploiter les ressources de manière plus flexible, tout en maintenant un certain degré de mobilité. Par exemple, dans les Alpes-Maritimes, la transhumance est attestée au cours du Néolithique. Cette pratique saisonnière consiste à déplacer les troupeaux entre les pâturages d’été en montagne et les pâturages d’hiver dans les vallées, assurant ainsi une gestion optimale des ressources fourragères.
L’impact démographique des innovations néolithiques
Toutes ces innovations entraînent une croissance démographique notable. L’humanité passe de quelques centaines de milliers d’individus à quelques dizaines de millions.
Cette augmentation de la population est en grande partie due aux avancées agricoles et à la domestication des animaux, qui fournissent des ressources alimentaires plus stables et abondantes. La transition vers une économie agricole permet aux communautés humaines de produire plus de nourriture sur une superficie donnée, soutenant ainsi une population plus dense et plus permanente.
De plus, l’agriculture permet l’accumulation de surplus alimentaires, qui peuvent être stockés pour les périodes de pénurie, améliorant la résilience des communautés face aux aléas climatiques et environnementaux. L’essor de l’agriculture et de l’élevage favorise également le développement de structures sociales plus complexes, avec l’émergence de hiérarchies sociales, de spécialisation du travail et de nouvelles formes d’organisation politique et économique.
Les villages et les villes commencent à se former, devenant les centres de la vie sociale et économique, où les innovations technologiques et culturelles se diffusent et se développent. L’impact de ces changements se fait sentir à travers toute l’histoire humaine, jetant les bases des civilisations modernes.